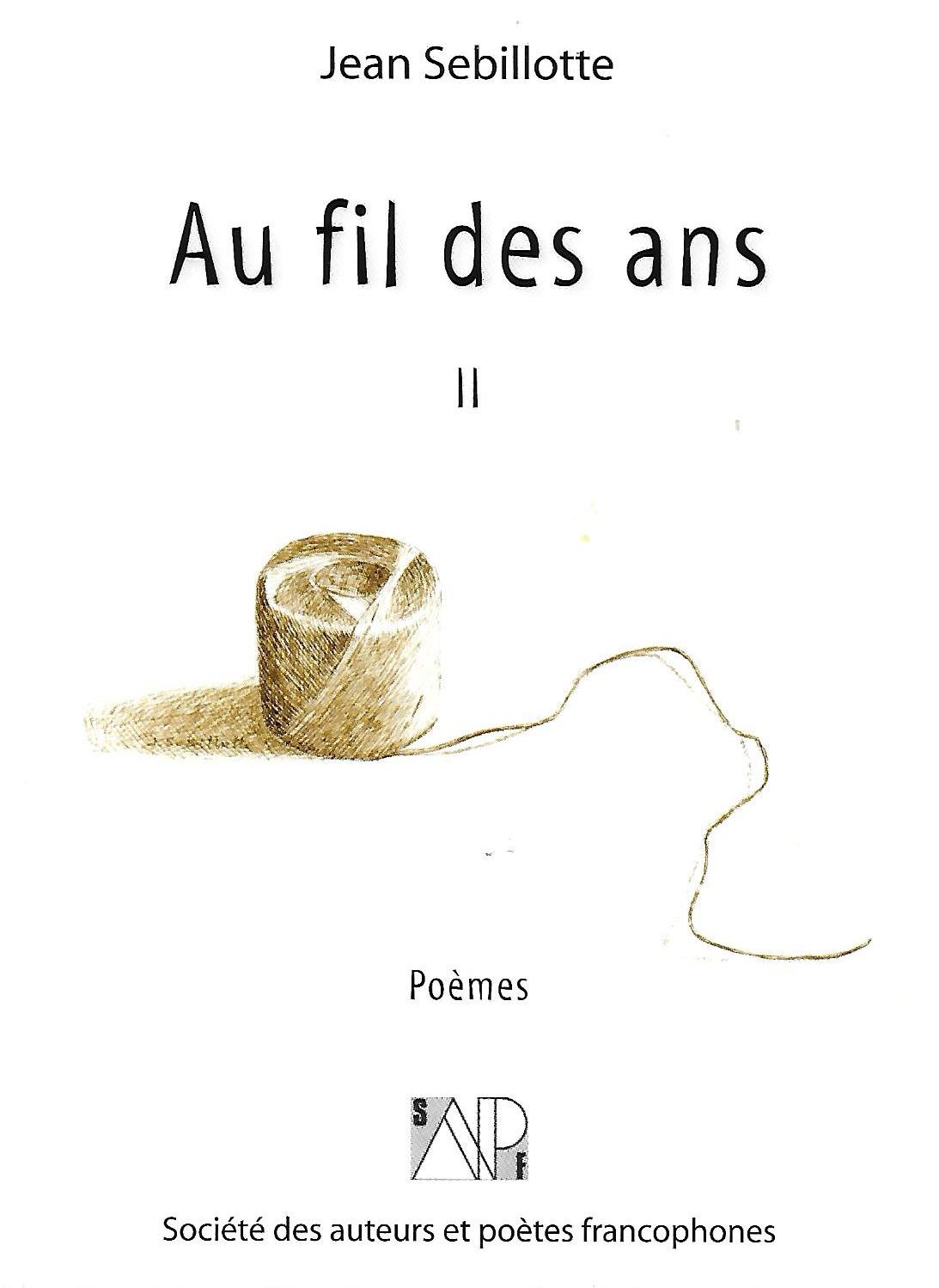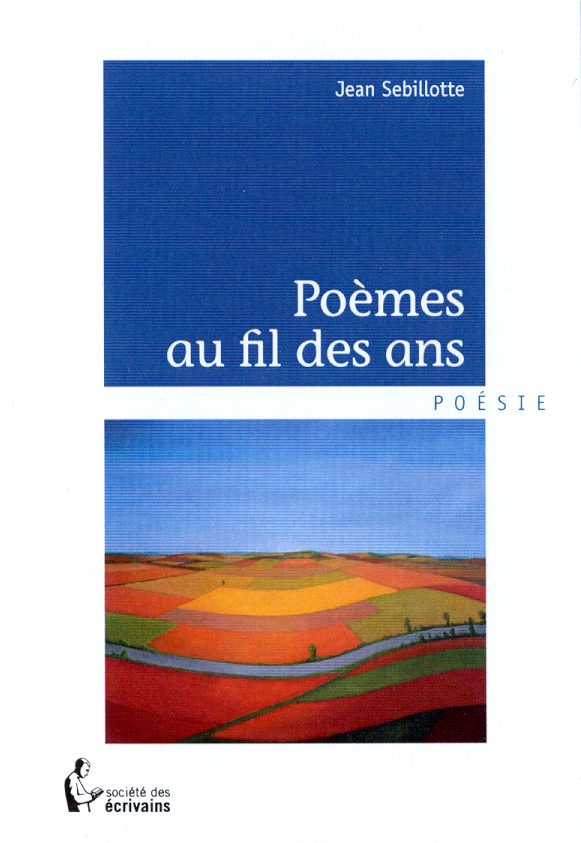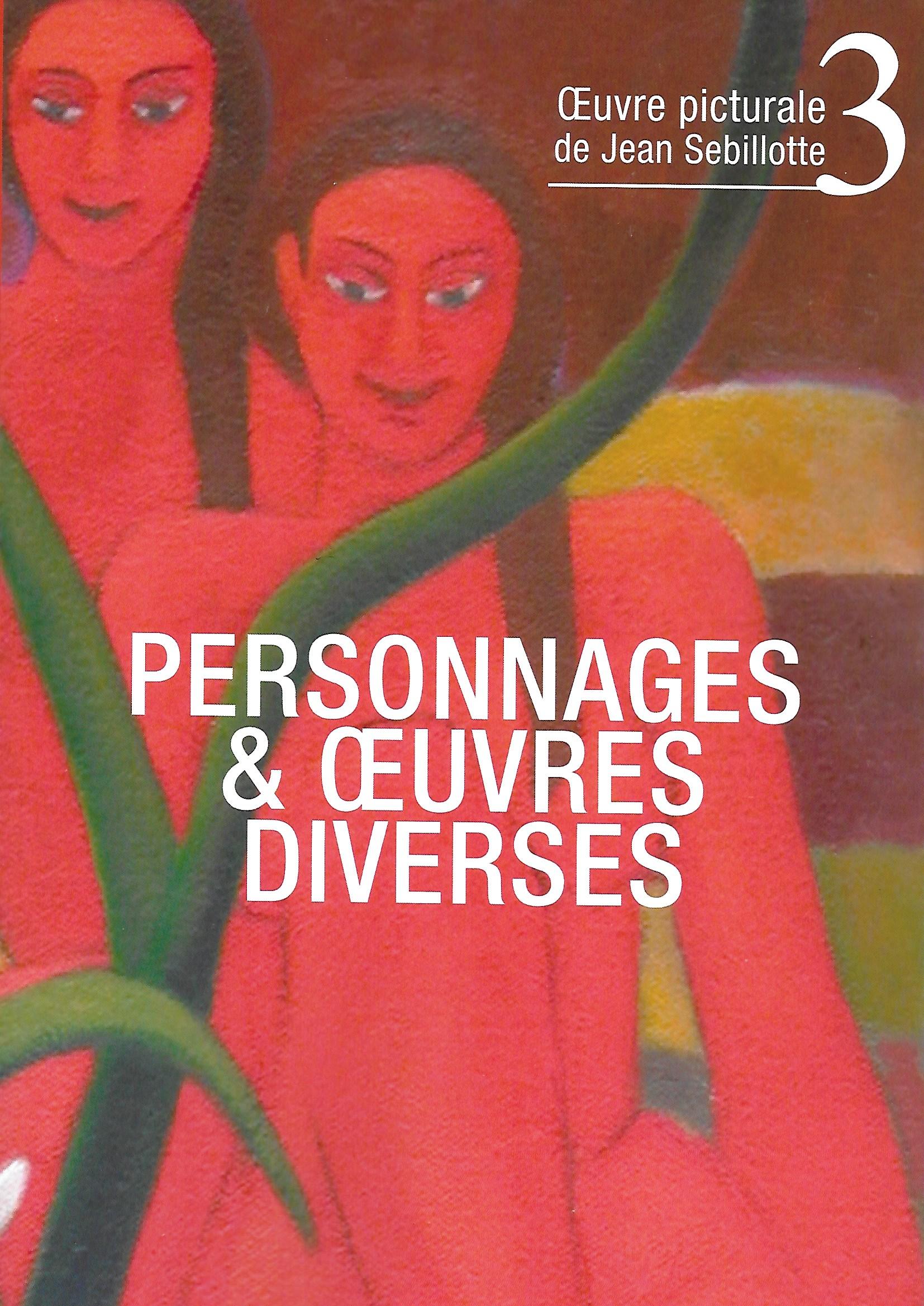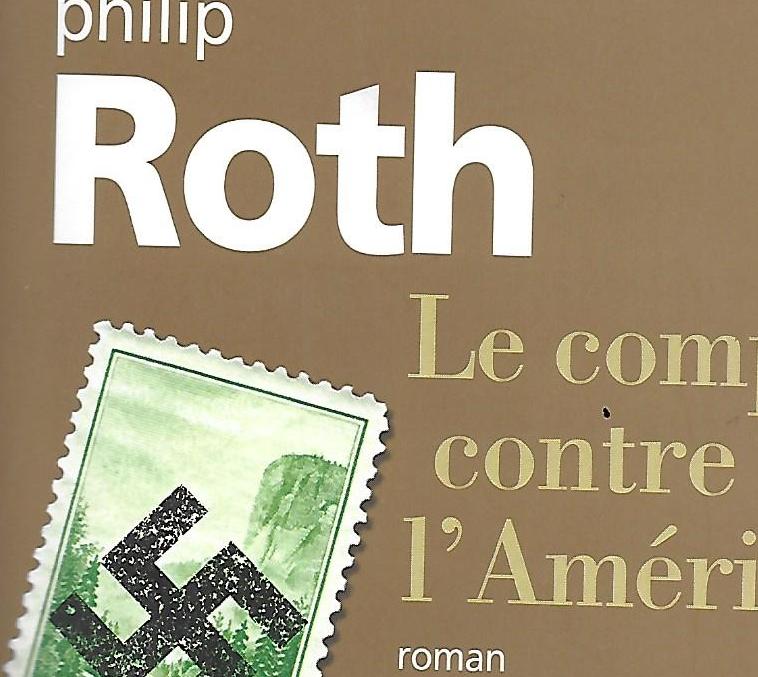Brunetière
ca. 1900 |
En littérature – prose ou vers – comme aussi bien en peinture, comme en musique, et généralement dans tous les arts, le style, dont on a donné, dont on donne encore tous les jours tant de définitions, si prétentieuses, et qui se croient « philosophiques », n’est, à vrai dire, et en trois mots, que la manière de s’exprimer. Le style d’Homère, c’est sa « manière de s’exprimer », en tant qu’elle diffère de celle de Dante ou de Shakespeare, et le style de Tite-Live, c’est sa « manière de s’exprimer », en tant qu’elle diffère de celle de Machiavel ou de Montesquieu. Tel étant le vrai sens du mot, dans son acception la plus étroite comme dans sa signification la plus large, il suffit donc de le développer pour se rendre compte que la définition non seulement convient à tout le défini, mais qu’elle ne convient qu’au seul défini, ce qui est, d’après les logiciens, le signe auquel se reconnaît une définition bien faite. Les conséquences qui en résultent achèveront de la juger et, en la jugeant, de la vérifier.
Et premièrement : – de ce que le style n’est autre chose en tout art que la manière de s’exprimer, il en résulte que le style n’existe pas en soi ni d’une manière abstraite; et aucun ouvrage « bien écrit » ne l’est pour les mêmes raisons ni par les mêmes qualités qu’un autre ouvrage « bien écrit ». C’est ici la grande erreur des Poétiques, des Rhétoriques et des Esthétiques. Toutes ou presque toutes, elles supposent un modèle ou un idéal, un canon du « bien écrire » ou du « bien peindre »; elles essaient de le déterminer; et il est vrai que, si quelqu’un essaie de s’y conformer, on est tout étonné de ne le voir aboutir qu à ce genre de beauté « qui est comme l’eau pure, disait Winckelmann, et qui n’a point de saveur particulière », mais les grammairiens ne s’en montrent pas autrement troublés. Ce qui est plus surprenant encore, ou plus fâcheux, c’est quand une certaine critique, s’autorisant de cet idéal ou de ce « canon » – plus sacré pour elle que celui des Ecritures – décide que Saint-Simon, par exemple, ou Molière écrivent mal, pour ne s’y être point docilement soumis, et découvre d’inattendus solécismes dans les vers de Racine ou dans la prose de Bossuet! Elle ne réfléchit pas que le style, en tout art, serait, comme on dit, à trop bon marché, s’il y avait des « règles » certaines et absolues du bien peindre ou du bien écrire, et qu’on les apprit à l’école, en même temps que « l’art d’écrire ou de parler correctement ». Mais c’est ce qu’on ne voit pas qui arrive. Et, en effet, ni la correction, ni même la parfaite clarté ne sont le style, ni même du style, étant, par définition, des qualités qui s’enseignent. Ou apprend à mettre le sujet avant son verbe, et le verbe avant son attribut on avant son régime; on apprend à ne point faire d’amphibologies; on apprend à vérifier dans le Dictionnaire, ou, ce qui vaut mieux, dans l’usage des grands écrivains, l’aloi, le titre, le sens et la juste portée des mots; on apprend à ne point faire de trop longues phrases, ni de trop courtes; on apprend encore à « suivre » ses métaphores on ses comparaisons, – ce qui mène d’ailleurs tout droit à dire, comme Cathos, « Contentez un peu l’envie que ce fauteuil a de vous embrasser », puisqu’en effet un fauteuil a « des bras » ; – mais rien de tout cela n’est du style ni le style. On peut, en écrivant, faire preuve de tontes cas qualités ou de toute cette science, et cependant n’avoir point de style, comme on peut aussi ne les pas avoir, et, néanmoins être un grand écrivain. « Le style élégant st si nécessaire, a dit quelque part Voltaire, dans son Dictionnaire philosophique, à l’article Style, que sans lui la beauté des sentiments est perdue », et, voilà qui pour être clair n’en est peut-être pas plus élégamment écrit; mais c’est dommage que là-dessus Voltaire ait négligé de définir « le style élégant ». Était-ce peut-être celui de sa Nanine :
Non, il n’est rien que Nanine n’honore ?
ou celui de sa Zaïre:
Votre plus jeune fils, a qui les destinées
Avaient à peine encore accordé quatre années ?
La définition de Buffon est meilleure :
« Le style n’est que l’ordre et le mouvement qu’on met dans ses pensées. »
Mais La Bruyère nous en suggère une meilleure encore, et, à ce qu’il nous semble, très voisine de la vérité, quand il écrit :
« Moïse, Homère, Platon, Virgile, Horace, ne sont au-dessus des autres écrivains que par leurs expressions et leurs images ».
C’est comme s’il disait que le style est chose individuelle, et bon ou mauvais, le style d’un artiste on d’un écrivain n’est un « style » qu’autant qu’il n’appartient qu’à lui. C’est en ce sens aussi qu’il faut interpréter la parole de Buffon : « Le style est l’homme même », et ne pas croire qu’il ait voulu dire, que tout le monde ait du style, ce qui est la pensée qu’on lui prête, sans s’en apercevoir peut-être, quand on lui fait dire que le caractère de chacun de nous s’exprimerait dans ses écrits. On connaît de très grands écrivains dont le caractère a beaucoup différé de celui de leur style, Rabelais, par exempte, ou encore Bossuet. Mais ce qui n’appartient qu’à eux, en des temps et en des genres sans doute assez différents, c’est leur « manière de s’exprimer ». D’autres qu’eux, de leur temps, ont eu ou peuvent avoir eu les mêmes idées, mais ils ne les ont pas exprimées de la même manière, et c’est pour cela que ces autres ne sont ni Bossuet ni Rabelais. Il y aura donc autant de styles qu’il y aura de « manières de s’exprimer » ou d’exprimer une même idée; et ainsi tombe encore l’enseignement de toutes les Poétiques, Rhétoriques et Esthétiques lorsqu’elles veulent nous faire croire que de plusieurs « manières d’exprimer » une même idée, il n’y en aurait qu’une qui serait la bonne. Autant vaudrait dire qu’il n’y a qu’une manière de penser ou de sentir.
Mais ce qui est vrai, et d’où nous allons voir sortir des conséquences nouvelles, c’est que notre « manière d’exprimer » nos sensations, nos sentiments ou nos idées, ne dépend pas uniquement de nous, je veux dire de ce que nous sommes; et elle nous est la plupart du temps comme imposée par les circonstances. Et d’abord, les « esprits originaux », quoi qu’en ait dit Pascal, sont rares, et rares aussi ce qu’on pourrait appeler les « tempéraments particuliers ». L’espèce humaine sent et pense en groupe. Il y a des « modes » en fait de sentiments ou d’idées comme d’habits, il y a des usages, des préjugés, des conventions; il en a donc en matière de style. Il y a aussi des familles d’esprits. Par exemple, on a fait ingénieusement observer qu’il y avait quelque chose d’Horace, non seulement dans notre Béranger, l’auteur des Chansons, mais encore chez tous les « retraités » qui ont consacré les loisirs de leurs dernières années à le traduire en vers ou en prose; il y a donc des modèles naturels de style, comme il y a des formes de nez ou des couleurs de cheveux. Et enfin il y a des écoles, c.-à-d. des élèves qui acceptent la discipline d’un maître, qui ne développent leur talent qu’à l’ombre et, pour ainsi parler, dans la direction du sien, dont il arrive même – en peinture notamment, – que la « manière ». se distingue malaisément de la sienne. On admire des Raphaëls qui ne sont quelquefois que du Jules Romain, – et on pourrait, je crois, prouver que Rubens n’a pas pu peindre toutes les toiles qu’il a signées. Pareillement, et chez nous, dans l’histoire de notre théâtre français, celui-là serait bien habile qui distinguerait une tragédie de La Harped’avec une tragédie de Marmontel, ou l’une et l’autre d’avec une tragédie de Voltaire. Heureux sont-ils de les avoir signées! à moins qu’ils n’eussent mieux fait, tous les trois, de n’en pas écrire. Evidemment, toutes ces causes contrarient, limitent, restreignent, elles commandent, elles « conditionnent » notre manière de nous exprimer; – et c’est ainsi que nous pouvons parler d’un « style » Renaissance ou XVIIIe siècle. Ce qui le distingue d’un style individuel, ou du style au vrai sens du mot, c’est que la somme des qualités et défauts qui relèvent de « la manière de s’exprimer » commune l’emporte sur la somme des défauts ou des qualités personnels à l’artiste ou à l’écrivain. Et, en effet, prenons encore les sonnets de nos poètes de la Pléiade : Ronsard, du Bellay, Baïf, Pontus de Tyard, Jodelle, etc., il faut creuser assez profondément pour découvrir enfin sous le style de l’école et de l’époque la personnalité du poète; et peut-être qu’à vrai dire on n’y réussit pas toujours.
D’autres causes, d’une autre nature, déterminent à leur tour ce style de l’époque ou de l’école, au nombre desquelles deux des plus agissantes sont ce que l’on pourrait appeler le génie des races ou des lieux, et la nature ou l’âge, le point de développement d’une langue. C’est ainsi qu’un contemporain de Rabelais ne pouvait pas écrire comme un contemporain de Voltaire, et, dans un autre art – puisqu’en un certain sens, tout art, étant un système de lignes, est donc une langue – c’est ainsi qu’un contemporain de Boïeldieu ne pouvait pas écrire comme un contemporain de Wagner. A cet égard, la « manière de s’exprimer » dépend de la nature des moyens généraux d’expression dont l’artiste dispose. Un bon exemple en est la prodigieuse révolution opérée dans l’art de la peinture par la seule généralisation des procédés de la peinture à l’huile. La liaison des révolutions de notre poésie française avec l’évolution des exigences de la rime en serait un second. A un moment donné de l’histoire d’une langue ou des moyens d’un art, toute une partie du « style » est donc ainsi engagée ou comme hypothéquée à des lois que l’artiste ou l’écrivain n’ont pas faites et qui masquent en quelque sorte l’expression de sa personnalité. Si nous voulons juger du « style » de Rabelais, nous ne le pouvons qu’en fonction, pour ainsi parler, de l’état de la langue de son temps, et il n’est le sien que par celles de ses parties qui l’en distinguent.
Nous ne le pouvons aussi qu’en fonction du génie de cette langue, en tant qu’il diffère du génie des autres langues, et la mesure du bien écrire n’est évidemment pas la même en français qu’en anglais ou en italien. C’est ce que l’on comprendra bien si l’on fait attention, par exemple, à l’habituel emploi du mot de « style » dans l’art de l’architecture : style grec, style roman, style byzantin, style gothique, et ne pourrait-on pas dire de nos jours : style anglais, style allemand, style américain? Non omnis fert omnia tellus. Il y a une corrélation entre l’architecture et le paysage, la civilisation, la religion grecques. Pareillement, l’âme successive d’un peuple et son histoire sont comme déposées dans l’histoire de sa langue, et l’originalité de l’écrivain, sa « manière de s’exprimer », son « style » ne peuvent se développer que dans le sens de cette histoire. Chaque langue a ses caractères, à elle, d’où s’engendrent des « manières de s’exprimer » qui ne se transportent point dans une autre langue; et de là, conséquemment, de certains caractères très généraux du « style ». Le « naturel » de l’espagnol serait déclamatoire en français, y prendrait le nom d’ « emphase »; et inversement, ce qui n’est que « naturel » en français a souvent passé, dois-je dire pour « cynique », cynical en anglais? Comparez encore la simplicité de l’éloquence grecque à ce que l’on pourrait appeler l’enflure de l’éloquence latine.
Et d’autres convenances enfin s’imposent à l’artiste ou à l’écrivain pour déguiser son originalité : ce sont celles qui résultent de la nécessité d’approprier le style aux genres que l’on traite. « Le style de Balzac n’aurait pas été mauvais pour des oraisons funèbres, et nous avons quelques morceaux de physique dans le goût du poème épique et de l’ode ». La rhétorique classique ne s’est montrée nulle part plus sévère que dans l’application de cette règle, ou, pour parler plus correctement, dans l’application de la règle que suppose cette plaisanterie de Voltaire; et en effet, c’est qu’il y va de la distinction des genres. Le style de la tragédie devait être « noble » et celui de la comédie « familier » : tous les rhéteurs en convenaient. La distinction se fondait sur cette vérité d’évidence que, si Potyeucte et Dom Japhet d’Arménie sont également du théâtre, cependant on ne va pas les voir jouer pour en tirer le même plaisir; et comme on ne nous procure pas des plaisirs différents par les mêmes moyens, la distinction des styles résultait donc de la distinction des genres. Elle en résulte toujours. Le style du drame, en aucune langue, n’a jamais été celui de la farce, ni ne le sera jamais, et la raison en est qu’une certaine manière de s’exprimer fait partie, si l’on peut ainsi dire, de la réalisation même de la farce ou du drame. Mais ici encore, nous le voyons, des conditions qui lui sont extérieures empêchent donc l’artiste ou l’écrivain d’être entièrement maître de sa « manière d’exprimer ». Pourquoi faut-il que ce soient précisément ces conditions extérieures dont les anciennes rhétoriques ont prétendu faire les « lois du style! » Tandis qu’en vérité elles sont si peu ces « lois » qu’au contraire le « style » ne commence qu’au point où cesse leur empire, au moment où l’écrivain s’en affranchit et triomphe enfin des obstacles qu’elles opposaient à la manifestation de son originalité. Le style n’est que notre « manière de nous exprimer », mais cette manière n’en est une, et surtout elle n’est « nôtre » qu’à condition de différer des autres. Il y a d’ailleurs des cas, et ils sont nombreux, où il vaudrait mieux qu’elle n’en différât point!
Reste à savoir comment, par lequel de ses caractères, une « manière de s’exprimer » s’élèvera, comme dit La Bruyère, « au-dessus d’une autre », on au contraire sera considérée comme lui étant inférieure? Si nous voulons répondre utilement à cette question, commençons ici par distinguer la manière de l’écrivain véritable de celle du styliste. On sait assez que de très grands écrivains, Bossuet, par exemple, ou Molière, n’ont rien du « styliste », et inversement, les « stylistes » en général, semblent avoir eu plutôt l’ambition que le don ou l’instinct naturel du style : tels un La Bruyère, et un Flaubert. Ils atteignent, par des procédés, – dont l’artifice est quelfois visible et devient alors insupportable, ou tout au moins choquant, – ce que les écrivains véritables rencontrent, pour ainsi dire, sans y avoir presque tâché. Le styliste est à l’écrivain ce que le sophiste est au philosophe. Quelles sont donc celles de leurs qualités qui classent entre eux les écrivains véritables, et comme tels ? Ce n’est pas la noblesse, ni la profondeur des idées, et ce n’en est pas non plus la richesse ou la complexité. La complexité des idées n’aboutit trop souvent qu’à la confusion du style, et la profondeur qu’à l’obscurité. Ce n’en est pas davantage l’originalité, le caractère de nouveauté : des idées très simples, quasi-banales, ont souvent été revêtues d’un style admirable, et, en revanche, des idées très neuves et très originales ne suffisent pas à faire d’Auguste Comte un grand écrivain. Mais, si l’on veut bien réfléchir aux rapports assez mystérieux du langage et de la pensée, – ou, plus généralement, aux rapports d’un système quelconque de signes avec les choses qu’il signifie ; – si l’on fait attention que ce système, pour souple qu’il soit, ne les exprime jamais que d’une manière imparfaite ou approximative et, comme on dit, « inadéquate »; si l’on considère enfin que tout le travail ou l’effort d’écrire ne consiste qu’à se servir des mots de la langue pour tirer la pensée de son indétermination première et l’amener à une ressemblance toujours inachevée d’elle-même, il apparaîtra que le caractère essentiel du style, c’est le degré de fidélité avec laquelle il traduit la pensée. Un livre « mal écrit » c’est un livre dont l’auteur n’exprime qu’insuffisamment, ou maladroitement, ses idées; et autant qu’il y aura de formes de cette maladresse ou de degrés de cette insuffisance, autant y aura-t-il de défauts ou de vices du style.
Cela, sans doute, est évident pour les vices généraux du style, tels que, par exemple, la « diffusion» ou la « lourdeur ». Mais l’observation n’est pas moins vraie des vices plus particuliers. En quoi consiste la Préciosité, sinon en ce que, pour exprimer des idées très fines, on ne trouve que des alliances de mots ou des tours de phrase qui les suggèrent plutôt qu’ils ne les traduisent ou ne les égalent. Marivaux, pour exprimer des idées souvent très fines, a besoin de termes très rares, dont les combinaisons s’écartent de celles du commun usage; mais Racine, pour exprimer des idées aussi fines, des sentiments tout aussi subtils, et de la même nature que ceux où se comptait l’observation de l’auteur des Fausses Confidences, n’a besoin au contraire que de la langue la plus simple et la plus ordinaire. Comparez encore l’éloquence de Massillon avec celle de Bourdaloue. Semblablement, qu’appelons-nous un style « déclamatoire » ou « emphatique »? C’est une manière de s’exprimer où les mots dépassent les choses, nous en donnent une idée plus grande que nature, et ainsi ne les traduisent donc pas d’une manière adéquate. On en trouvera de nombreux exemples dans la littérature de l’époque romantique, dans les drames du vieux Dumas, et jusque dans les poèmes d’Hugo, dans ses Châtiments et dans sa Légende des siècles. Le burlesque, à son tour, n’est qu’une manière de rabaisser les choses que l’on dit par l’expression que l’on en donne. Est-il besoin, après cela, de montrer que la « platitude », que la « vulgarité » du style ne sont qu’autant d’espèces ou de formes de son insuffisance?
« Dire tout ce que l’on veut dire », et « ne dire que ce que l’on voulait dire », et « le dire comme il doit être dit » – telle semble donc être la définition du style, ou, pour mieux dire nous-mêmes, la définition de ce qu’il y a dans le style d’essentiel et de « spécifique ». Aussi n’est-ce pas la rhétorique qu’il faut interroger pour juger de la valeur d’un écrivain comme écrivain : c’est lui-même. Quoi qu’il ait voulu dire, nous lui demandons s’il l’a dit, comment il l’a dit, avec quel degré de clarté, de précision, de force. La plupart des écrivains sont au-dessus, ou au-dessous, ou à coté de leur pensée. Le triomphe du style ne consiste qu’à égaler sa pensée, et le reste n’est pas une question de forme, mais de fond. En d’autres termes, ce n’est pas, comme l’enseignaient les anciennes rhétoriques, le style en tant que style qui est « tragique » ou « comique », « poétique » ou « oratoire », « sublime » ou « tempéré » : ces distinctions apparentes, et discutables comme telles, ne sont à l’analyse qu’une perpétuelle confusion du style et de l’idée. C’est l’idée qui est « sublime » ou « moyenne »; c’est la pensée, le sentiment qui sont « poétiques » ou « oratoires »; c’est la matière enfin, non la manière qui est « tragique » ou « comique ». En ce sens, on a pu dire, et avec raison, qu’un beau vers de Boileau valait un beau vers d’Hugo. C’est ce qu’on dira pareillement d’une fresque de Raphaël et d’un portrait de Rembrandt, de l’Ecole d’Athènes ou de la Leçon d’anatomie. Du point de vue du style, une tragédie de Corneille vaut une comédie de Molière, Polyeucte vaut Tartufe; et, du même point de vue, si nous étions tentés pour notre part, de donner quelque préférence à une tragédie de Racine, comme sa Bérénice, c’est qu’à notre avis Racine, qui travaillait moins vite que Molière, et autrement que Corneille, a précisément atteint, dans ses chefs-d’œuvre, cette perfection qui consiste à exprimer sa pensée d’aussi près que possible : Molière est souvent un peu en deçà de la sienne, et Corneille un peu au delà.
Pouvons-nous tirer maintenant, de ces considérations ou de ce principe, quelque classification qui remplace heureusement celle des anciennes rhétoriques? Je le crois; et le style, à son premier degré, sera l’art de rendre on d’exprimer fidèlement en chaque genre l’idéal de toute une école. On en peut prendre comme exemple, en peinture, ce style Lombard, qui est tel, et si nettement caractérisé, qu’on ne connaît pas, d’une part, une toile de Léonard de Vinci, qui ne puisse être de quelqu’un de ses élèves, et, d’autre part, qu’un ne saurait, presque en aucun cas que je connaisse, la croire de l’école Florentine ou de l’école Napolitaine. Un autre exemple sera celui du style Janséniste au XVIIIe siècle, le style, non de Pascal, qui n’appartient qu’à Pascal, mais celui des Arnaud, des Nicole, des Duguet, et j’ajouterai le style de Bourdaloue. Les Sermons du célèbre jésuite, comme les Essais de Nicole, représentent excellemment la langue moyenne de l’époque : ils n’ont pas de « saveur particulière ». Un Essai de Nicole se distingue aisément d’un Sermon tout entier de Bourdaloue, parce que Bourdaloue est un maître dans l’art de composer, et, indépendamment de tout autre mérite, ses Sermons valent par la beauté de leur architecture, qui est singulière et unique, mais on aurait peine à distinguer une « page » de Bourdaloue d’une page de Nicole, et c’est ici tout ce que l’on veut dire. Leur « style » ne leur appartient pas plus qu’à tous ceux de leurs contemporains qui « écrivent bien », et c’est peut-être pour cette raison que leurs contemporains ont fait en vérité de Nicole presque autant de cas que de Pascal, et de Bourdaloue que de Bossuet.
A un degré déjà supérieur quelques écrivains ou quelques artistes ont eu le don d’exprimer leurs idées sous une forme plus originale, mais dont l’originalité ne consiste pourtant encore que dans le caractère définitif qu’ils ont su donner à des sentiments très généraux. Tel est La Rochefoucauld, par exemple, en ses Maximes, ou tel encore, dans un genre un peu différent, et en vers, l’auteur des Satires. Tels sont encore, dans la comédie, le brillant auteur des Folies Amoureuses, du Joueur, du Légataire universel, et, dans le roman, l’auteur moins brillant, mais plus mordant, de Gil Blas et du Diable boiteux. Une phrase de celui-ci nous vient à propos sous la plume :
« On nous réconcilia, nous nous embrassâmes, et depuis ce temps nous sommes ennemis mortels ».
Le style, ici, consiste à combiner les mots de l’usage commun et familier d’une manière qui en étende la signification à tous les cas analogues, et ainsi qui leur donne ce qu’on appelle une «valeur proverbiale». Boileau, comme on le sait, est plein de ces proverbes. On en trouve aussi beaucoup dans Molière. Mais déjà Molière, au travers de son « galimatias », – c’est le mot à la fois injuste et vrai de Fénelon, – tend constamment à une forme supérieure de style, très difficile à définir, et qui n’achève de se réaliser pleinement que dans l’enivre des tout à fait grands artistes et écrivains.
Considérons pour nous en rendre compte ce vers de Britannicus :
Ces murs même, seigneur, peuvent avoir des yeux;
ou ces phrases de Pascal :
« Le froid est agréable pour se chauffer. » – « Nous sommes pleins de choses qui nous jettent au dehors. » – « Il y a des vices qui ne tiennent à nous que par d’autres, et qui en ôtant le tronc s’emportent comme des branches »;
ou ces vers d’Hugo sur Rabelais :
Il berce Adam pour qu’il s’endorme,
Et son éclat de rire énorme
Est un des gouffres de l’esprit.
Dans tous ces cas, et autres semblables, la combinaison des mots est telle qu’elle ne saurait servir ailleurs ni deux fois : on ne dira pas une autre fois qu’un « éclat de rire » est un « gouffre » et « un gouffre de l’esprit »; on ne dira pas une autre fois qu’ « un mur a des yeux » ni qu’il y faille faire attention. Il y a là un emploi « unique » de mots, qui d’ailleurs sont ceux de l’usage commun, – car on évoluerait, s’ils n’étaient pas de l’usage commun, vers la préciosité ou vers le galimatias ; – l’expression est « signée» pour ainsi dire; on ne la «démarquera» pas; elle sera toujours et pour toujours de Racine et de Victor Hugo. Nous disons bien, et on le voit : l’expression, et non la pensée. Il n’y a nulle originalité, ni même un grand effort d’esprit à nous aviser que, de même que l’on peut nous entendre, ainsi parfois peut-on nous «voir» au travers d’un mur que l’on eût cru opaque; et ce n’est pas Hugo qui a trouvé le premier je ne sais quoi d’énigmatique ou de déconcertant dans le rire de Rabelais. C’est donc bien la forme qui est ici constitutive du «style»; et ainsi, pour en revenir à notre définition, nous ne voyons nulle part mieux que dans le dernier triomphe du style qu’il ne consiste uniquement que dans «la manière de s’exprimer». La correction et la clarté n’en sont, pour ainsi parler, que la base ou la condition grammaticale; elles ne sont pas le style lui-même, et elles n’y acheminent même point l’écrivain et l’artiste. La nature ou la qualité de la pensée, de l’idée ou du sentiment, nous croyons l’avoir montré, ne mesurent pas davantage la qualité du style. Et pour achever enfin de nous confirmer dans cette opinion, il aura suffi d’observer que les défauts du style ne procédaient que d’une impuissance ou d’un vice de la «manière de s’exprimer ».
Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement
Et les mots pour le dire arrivent aisément,
a dit Boileau, dans des vers célèbres. Ces vers eux-mêmes ne sont pas très clairs, et on en pourrait donner, comme du mot de Buffon : « Le style, c’est l’homme même », jusqu’à trois ou quatre interprétations. Pour les bien entendre, il faut donc les compléter, par une autre parole du même Boileau :
« L’esprit de l’homme, dit-il ailleurs, est naturellement plein d’un nombre infini d’idées confuses du vrai, que souvent il n’entrevoit qu’à demi, et rien ne lui est plus agréable que lorsqu’on lui offre quelque-une de ces idées éclaircie et mise dans un beau jour ».
Qu’est-ce à dire, sinon que : Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement, à condition que l’on soit un écrivain? que Les mots pour le dire arrivent aisément, quand on en a en naissant apporté le don de l’invention verbale, à quelque degré que ce soit? et qu’enfin, si ce don est précisément ainsi nommé de ce que l’on ne se le donne point, c’est « le législateur du Parnasse » qui renverse lui-même l’édifice tout entier de l’ancienne rhétorique? Un apprend à écrire correctement; mais le «style» ne s’enseigne point, ni les moyens de s’en former un, pas plus en peinture qu’en littérature ou en poésie; il est de ces choses qu’on analyse, mais qu’on ne reconstitue point ; et c’est justement pour cela que nous l’admirons dans les chefs-d’oeuvre de l’art et de la poésie. (F. Brunetière, ca. 1900). |

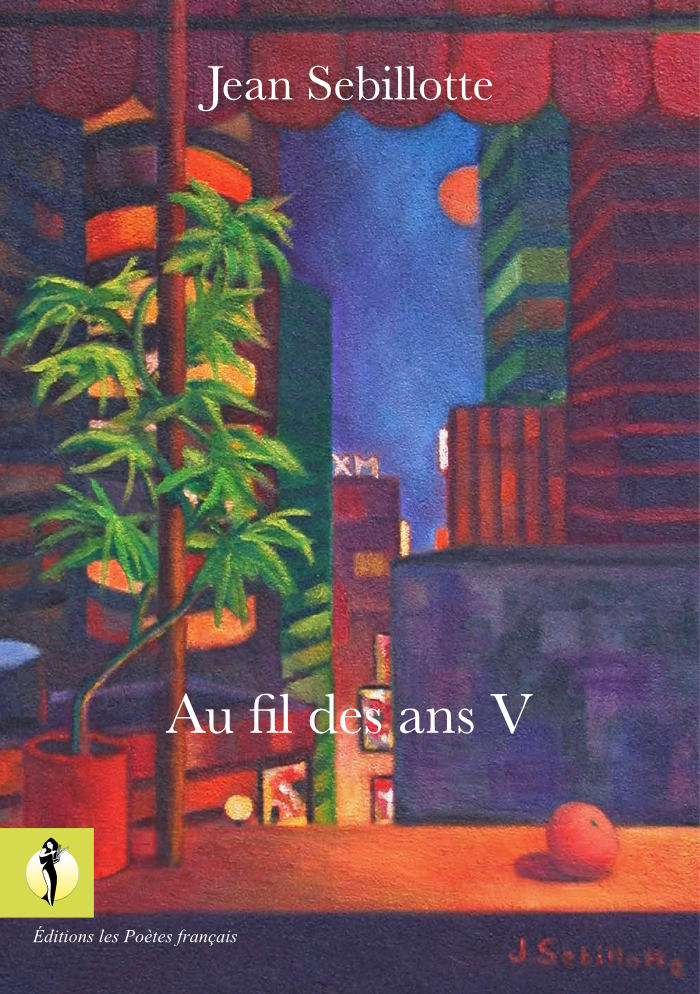
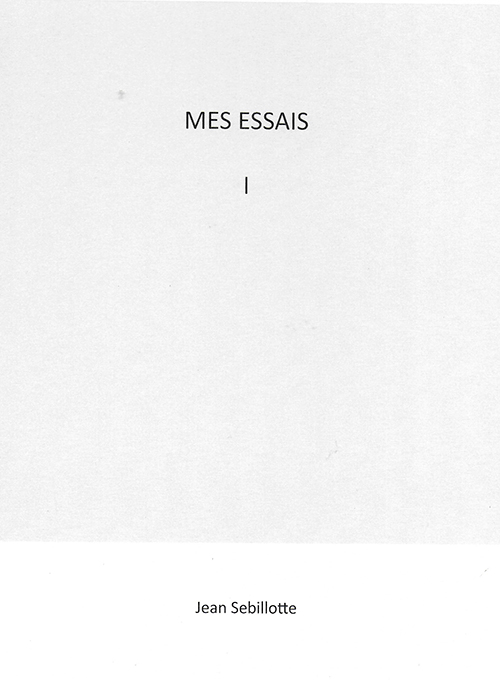
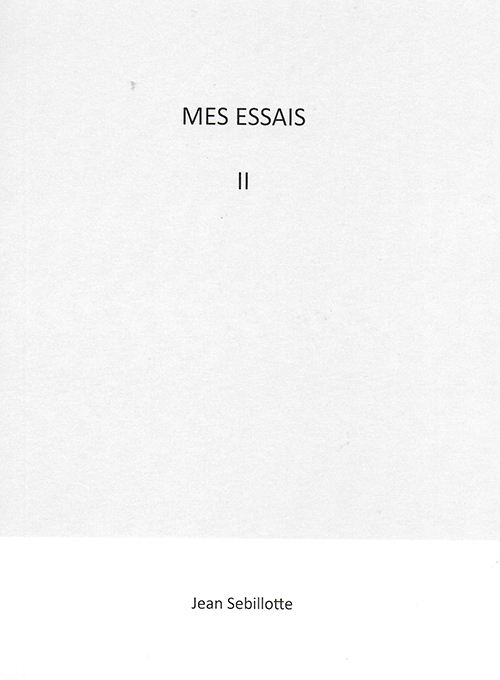
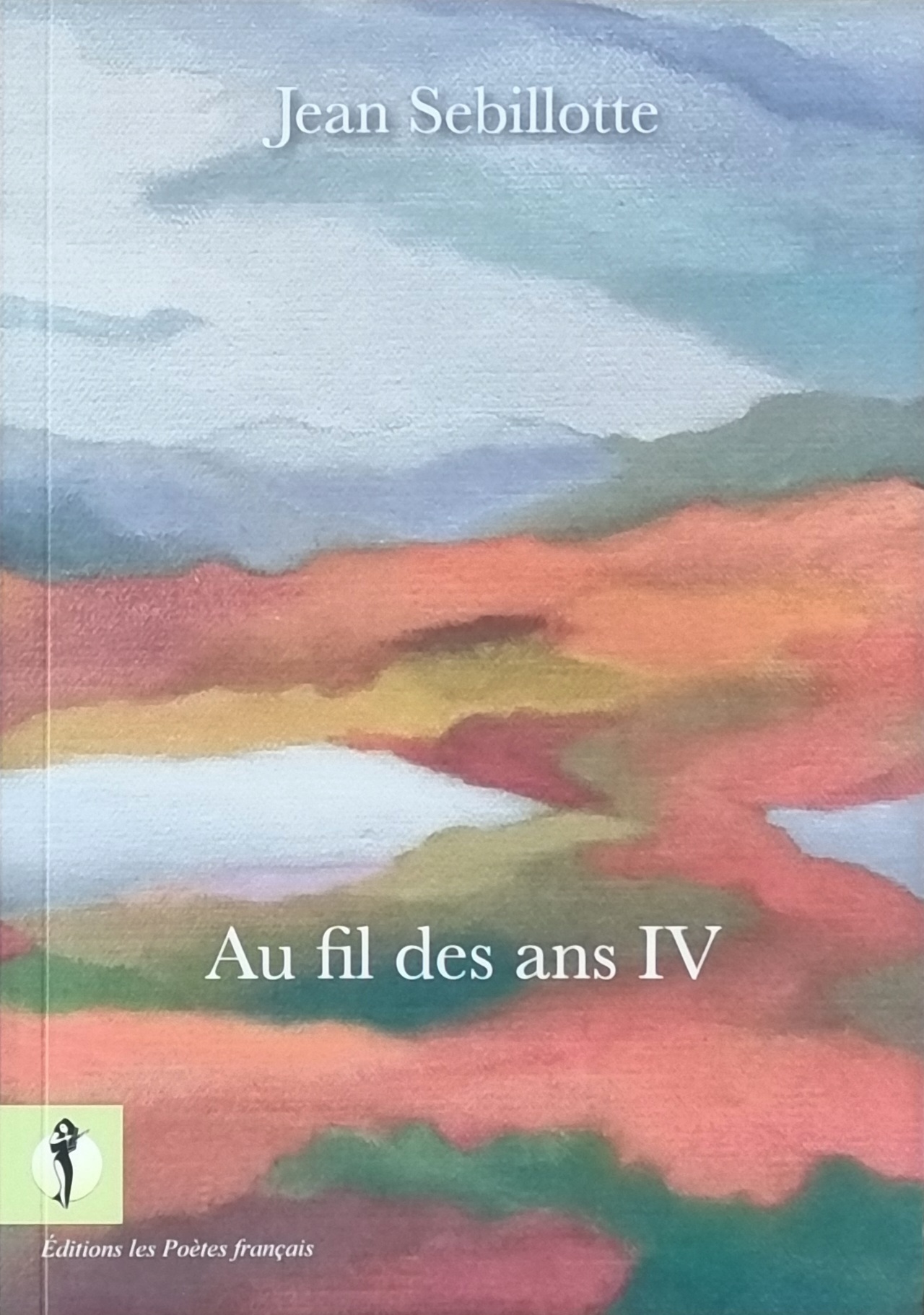

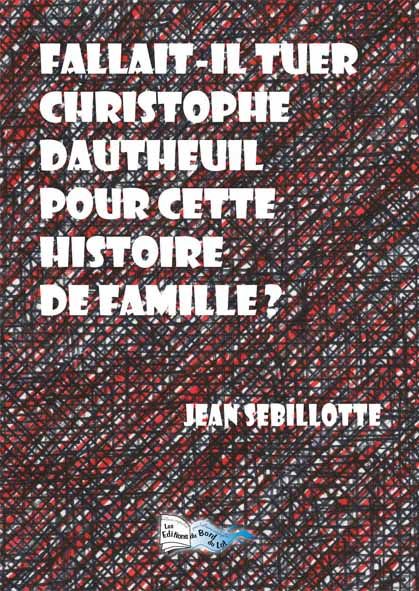 Se procurer ce livre : Editions du bord du Lot
Se procurer ce livre : Editions du bord du Lot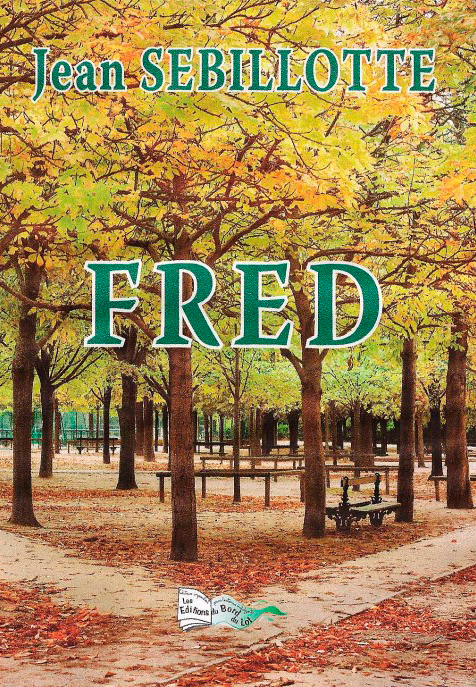 Se procurer ce livre : Editions du bord du Lot
Voir leur site
Se procurer ce livre : Editions du bord du Lot
Voir leur site