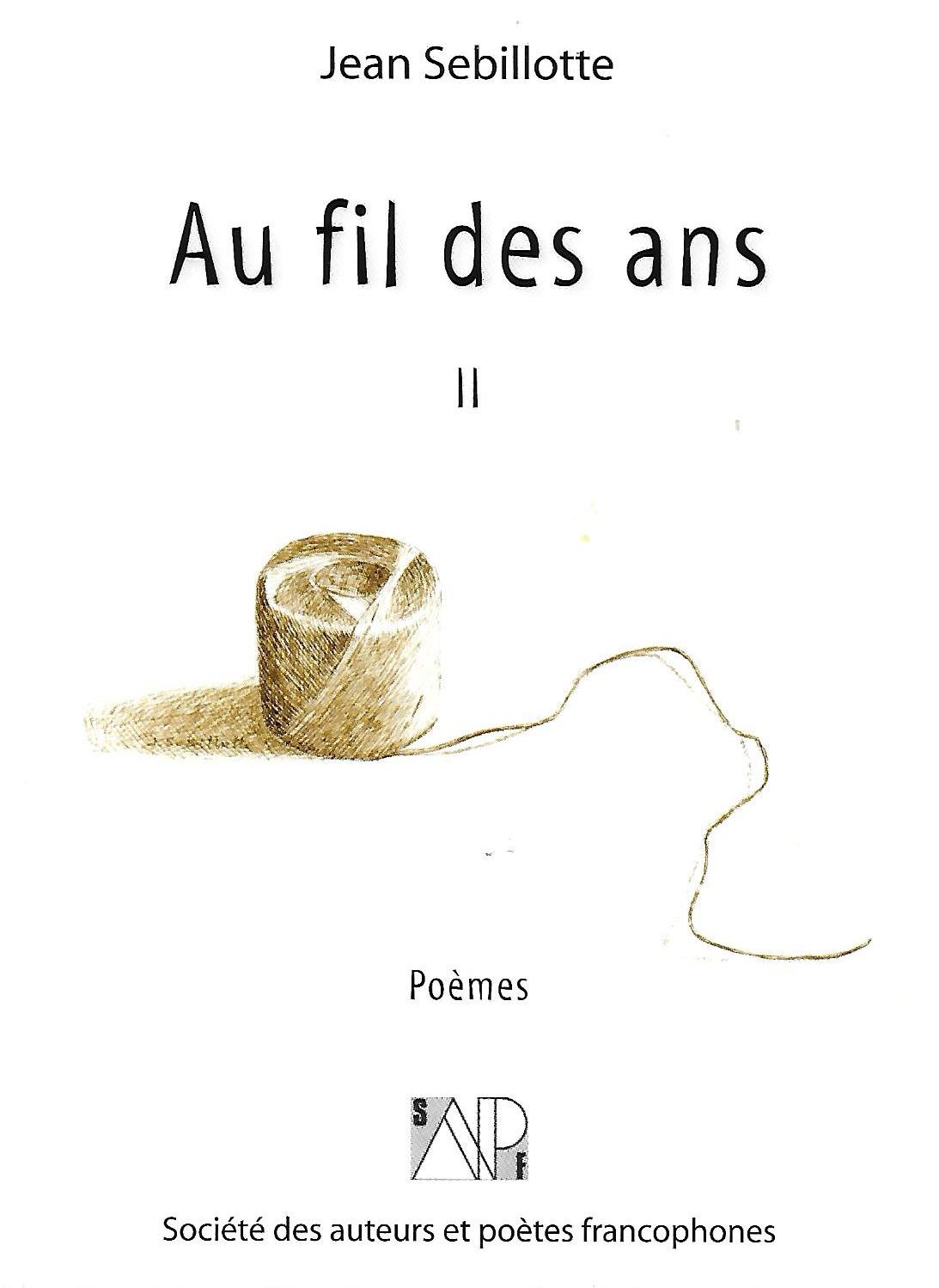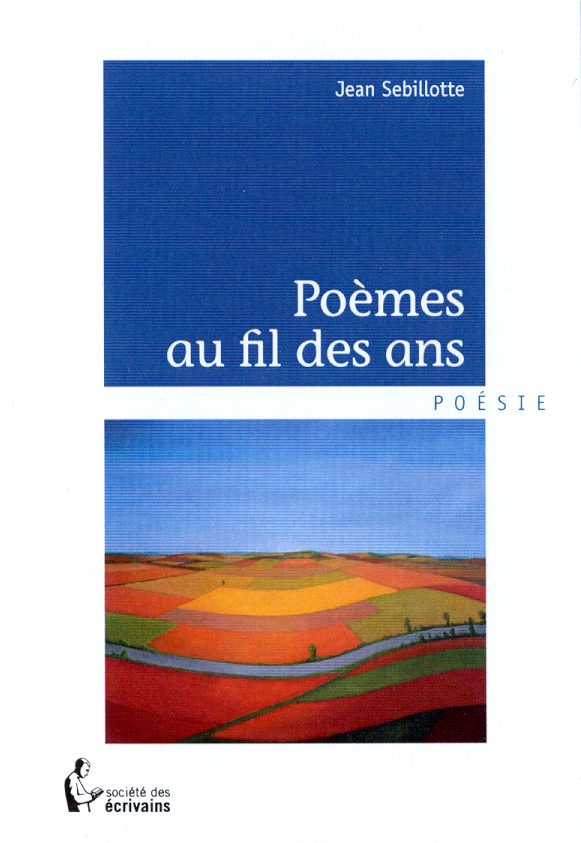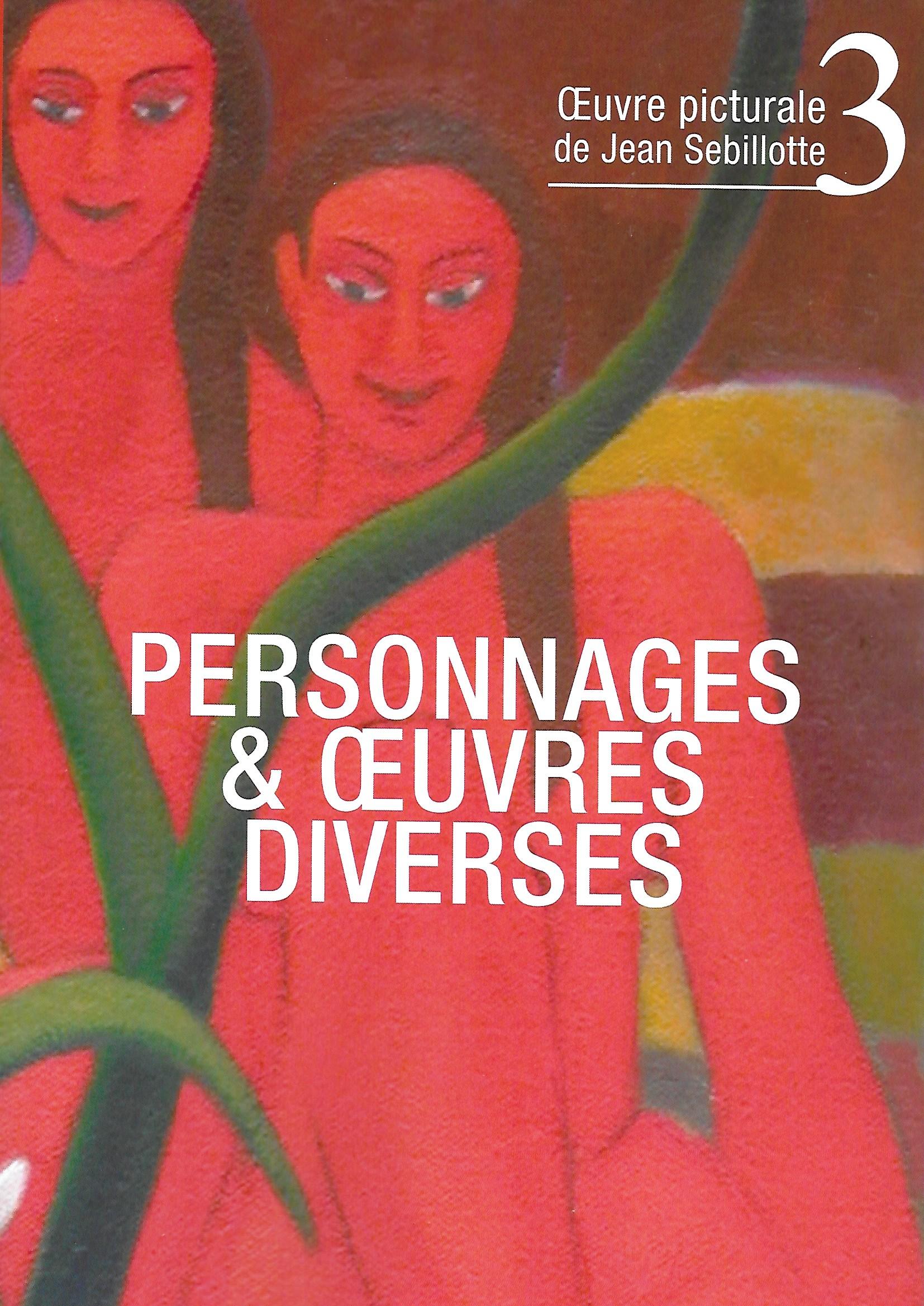avril 20th, 2013 par Jean Sebillotte
Pour tenter de comprendre mon vécu de jeune auteur et examiner ma situation, je commence à me balader sur la toile. Et voici ce que je trouve sur le site « envied’ecrire.com » et reproduis ici. Il y a quelques temps, j’évoquais Elisabeth George et son livre Mes secrets d’écrivains. Peut-on imaginer des démarches aussi dissemblables ?
Un jour, peut-être, expliquerai-je la façon que j’ai trouvée d’écrire ? Il serait prétention de le faire tant que je n’ai pas trouvé d’éditeur, autre que des gens qui m’ont publié à compte d’auteur. C’est là mon point de vue actuel. Peut-être changerai-je d’avis. Chi lo sa ?
Les secrets d’écriture de Patrick Modiano
 Né en 1945, Patrick Modiano est l’auteur d’une trentaine de romans publiés pour la plupart chez Gallimard. C’est en 1967 qu’il publie La Place de l’étoile, son premier roman sur l’Occupation couronné du prix Roger Nimier. Après La Ronde de nuit de 1969, il reçoit en 1972 le Grand prix du roman de l’Académie française pour Les Boulevards de ceinture. En 1978, il parvient à la consécration avec son sixième roman, Rue des boutiques obscures, en recevant le Prix Goncourt.
Né en 1945, Patrick Modiano est l’auteur d’une trentaine de romans publiés pour la plupart chez Gallimard. C’est en 1967 qu’il publie La Place de l’étoile, son premier roman sur l’Occupation couronné du prix Roger Nimier. Après La Ronde de nuit de 1969, il reçoit en 1972 le Grand prix du roman de l’Académie française pour Les Boulevards de ceinture. En 1978, il parvient à la consécration avec son sixième roman, Rue des boutiques obscures, en recevant le Prix Goncourt.
A l’occasion de la sortie de son roman Horizon en 2010, Patrick Modiano avait accordé un entretien au magazine français Lire.
Relisez-vous vos précédents romans avant d’écrire le nouveau ? Non, mais je suis obligé de le faire lorsque paraissent des éditions de poche. C’est très désagréable. J’ai toujours envie de corriger certains détails. C’est le problème des livres qui ont été écrits très jeune, c’est-à-dire jusqu’à 35 ou 40 ans. Vingt ans après, les lire procure un drôle d’effet. Semblable à celui que l’on ressent quand, à 60 ans, on se voit dans un film ou un documentaire à l’âge de 20 ou 30 ans… C’est très bizarre. Et cela interroge la question de l’âge. Je me demande ce que ressentent les vieux comédiens qui se revoient dans des films tournés lorsqu’ils avaient 20 ans. Ça doit être très dérangeant, non ? Se reconnaît-on ? Qui reconnaît-on ? J’ai l’impression que ce sentiment dérangeant se stabilise à partir de 45 ans. A cet âge, il peut encore y avoir des changements terribles, mais, pour l’essentiel, tout est joué.
Où situez-vous la frontière entre la fiction et le récit ? Le point de départ est toujours quelque chose de très précis qui ne relève pas de la fiction. Un détail. Ou une scène. Quelque chose qui a véritablement eu lieu. Un morceau de réalité. Après, je mélange ces bribes de réel à ce qu’elles auraient pu devenir. Et ça devient une sorte de fiction. L’horizon est né de cette façon : la scène primitive est une scène où je voyais quelqu’un attendre une autre personne à la sortie d’un bureau.
Comment écrivez-vous ? Je pars du concret pour aller vers la fiction. J’utilise souvent le nom de personnes qui ont vraiment existé parce que ça m’aide à soutenir l’échafaudage. Je détourne leurs noms, bien sûr.
Quelle est votre unité première : la phrase, le paragraphe ? La phrase. La première phrase, la plupart du temps. Mais quand on écrit, on part à l’aveuglette. Pendant le premier mois, je me sens très souvent découragé, je me demande si je dois continuer. C’est comme si je conduisais en plein brouillard, sans rien voir devant moi mais je poursuis ma route, sans savoir où aller, avec parfois la sensation ou la crainte de m’être engagé dans une voie sans issue. Mais ce qui est très bizarre, c’est que, quand j’ai cette intuition de m’être engagé sur une fausse route, j’essaie de rattraper la route principale plutôt que de faire marche arrière. Au lieu d’abandonner, de me dire : « C’est une fausse piste, il faut que j’arrête, tant pis », je continue et j’essaie de rattraper la route principale.
Avez-vous connu ce sentiment avec tous vos romans ? Oui, tous. Pour certains, il y a peut-être eu une petite ligne droite… Mais je ne suis pas comme ces écrivains qui tracent le sillon avec constance et confiance. Il y a toujours ou presque ce détour et cette sensation, au dernier moment, d’être comme un trapéziste qui parvient, in extremis, à rattraper le trapèze qu’on lui a lancé.
Par quel moyen (ou quel miracle) retrouvez-vous le chemin ? Comment rattrapez-vous le trapèze ? Par la phrase, justement. Un paragraphe ou une page qui me semblent catastrophiques le soir peuvent être rétablis le lendemain matin par une phrase. Ou en supprimant quelque chose. Mais j’ai, chaque matin, une impression de rattrapage de ce que j’ai fait la veille. Je n’ai jamais connu cette impression d’écrire en ligne droite. C’est comme si vous naviguiez en essayant d’éviter les écueils et que, au dernier moment, vous les contourniez. Utiliser des blocs de réalité, notamment des noms propres de gens que j’ai pu croiser, m’aide à effectuer ce rattrapage. Quelquefois, je cannibalise certains trucs, c’est-à-dire que je me sers de plusieurs segments qui pourraient chacun être un roman différent.
Ce qui explique que le lecteur ait souvent l’impression, à vous lire, que tel ou tel passage pourrait être le point de départ d’un autre roman…Oui, j’en suis tout à fait conscient. Pour essayer de redresser la barre, je me sers de segments qui auraient pu être développés dans des romans ultérieurs mais que j’ai besoin de mettre bout à bout dans celui qui est en cours d’écriture. Je suis comme quelqu’un qui essaie de trouver un dopage artificiel. Je cherche ce qui pourrait me stimuler. En joaillerie, on appelle cela un serti invisible. C’est-à-dire que l’on ne s’aperçoit pas de la mise bout à bout de plusieurs segments, on ne voit que la fluidité. J’essaie de travailler ainsi. Ou plutôt, je ne peux que travailler ainsi. Ce qui me laisse toujours un sentiment assez désagréable.
Mais faut-il déduire de cette méthode que vous n’avez pas un rapport heureux à l’écriture ? Non. Ce qui aggrave mon cas, c’est cette rêverie préalable à tout commencement d’écriture et dont j’ai besoin avant de passer à l’acte. Je suis comme ces gens qui sont au bord d’une piscine et attendent des heures avant de plonger : écrire, pour moi, est quelque chose de désagréable, donc je suis obligé de rêver beaucoup avant de m’y mettre, de trouver des façons de rendre agréable ce travail assez long et difficile, de trouver un dopant. J’ai d’ailleurs compris, maintenant, la raison de l’alcoolisme de beaucoup de grands écrivains : je crois qu’il s’agit de cette perpétuelle baisse de tension et l’alcool fonctionne comme le grand dopant, même quand on a fini d’écrire.
Et vous, quel est votre dopant ? L’alcool ? Non, pas du tout. Je marche beaucoup. Je rêvasse. Je me mets dans une sorte d’état second à partir de morceaux de réalité, souvent du passé, parfois des noms propres. Cette perpétuelle hésitation transparaît peut-être dans mes livres… Je ne me rends pas compte.
Non, justement. (…) Pour arriver à cette fluidité, faites-vous un gros travail de réécriture ? Non. Je corrige parfois quelques phrases, bien sûr, mais lorsque j’ai terminé un livre, je ne le récris pas, je ne fais pas de changements, je ne le reprends pas. Il est écrit.
Quelle est votre discipline ? Si on n’arrive pas à écrire tous les jours, on perd le fil et le découragement s’installe. On se dit « à quoi bon ? » et c’est foutu ! J’écris tous les jours pour ne pas laisser le découragement s’installer en moi. Et parce que j’aurais trop de mal à reprendre après une interruption, même brève. On perd facilement le fil, dans ce genre de travail, vous savez… D’autant que, comme je vous l’ai dit, je ne vois jamais le but vers lequel mes livres tendent. Si je laisse passer un jour, je suis perdu. Je navigue à l’aveuglette, donc je dois naviguer chaque jour, sinon je coule.
Ce qui est frappant, c’est que vous n’avez aucune vue d’ensemble sur le livre que vous êtes en train d’écrire… Oui, en effet. Je sais que la plupart des écrivains savent où ils vont. Enfin, un peu… Moi, pas du tout. Tout en sachant, puisque je parviens, je crois, à redresser la barre.
Publié dans Articles, Ecriture, Lectures Etiquette: écriture, Secrets d'écriture, témoignage

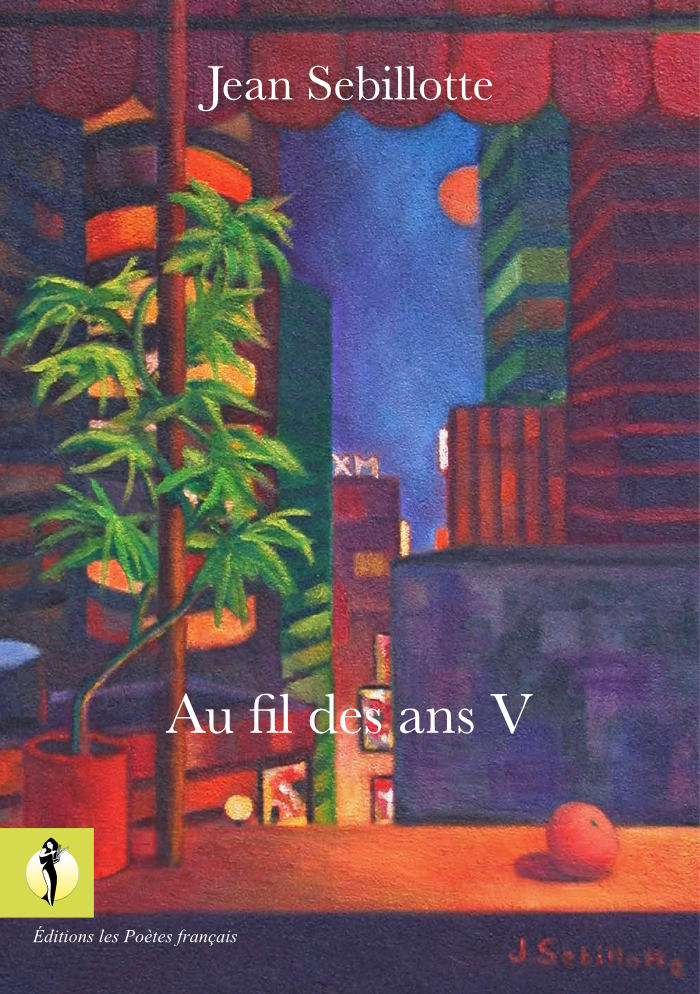
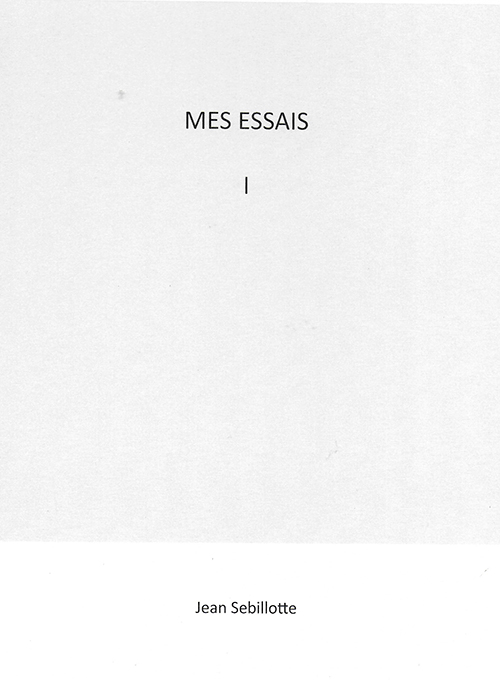
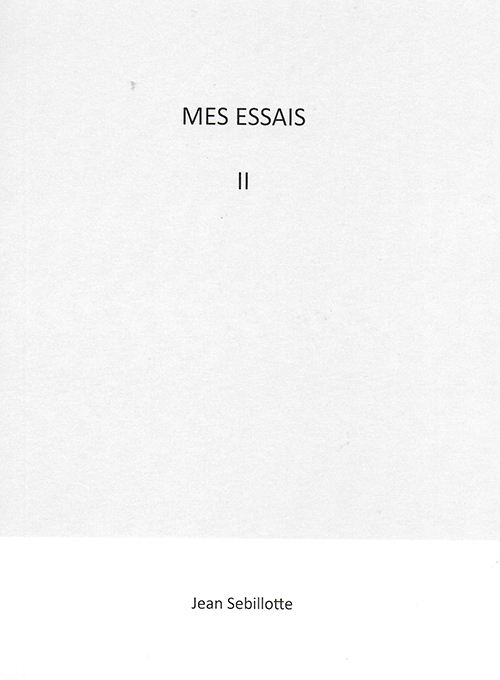
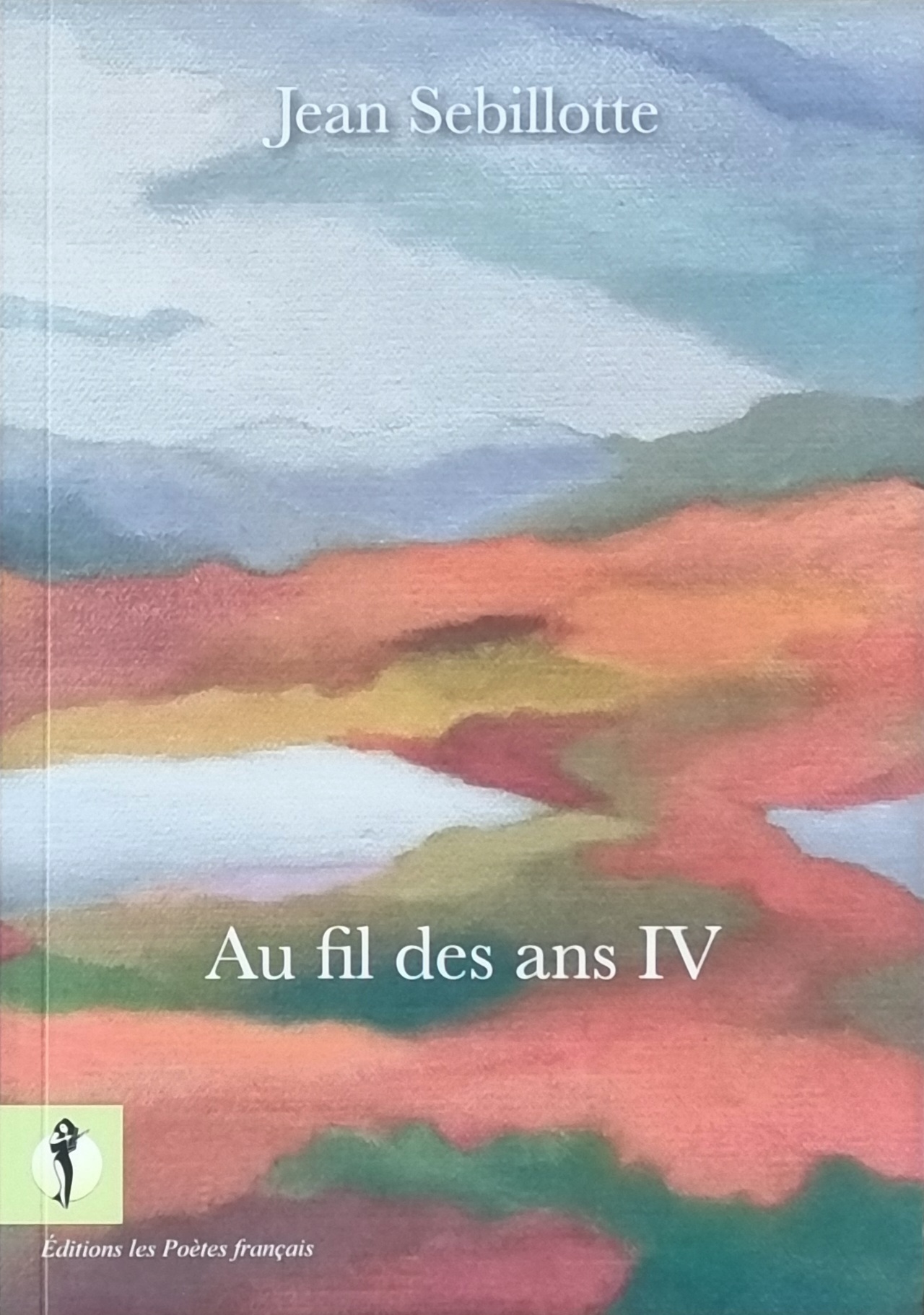

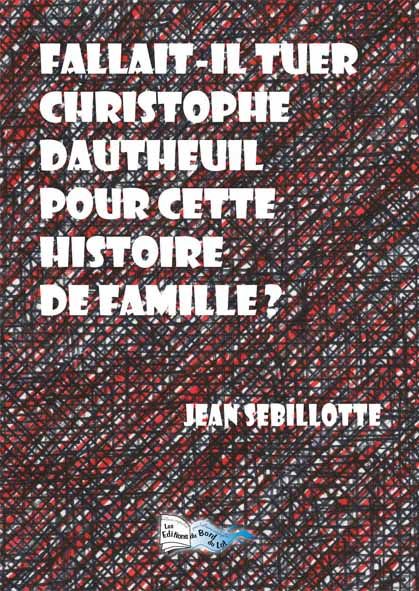 Se procurer ce livre : Editions du bord du Lot
Se procurer ce livre : Editions du bord du Lot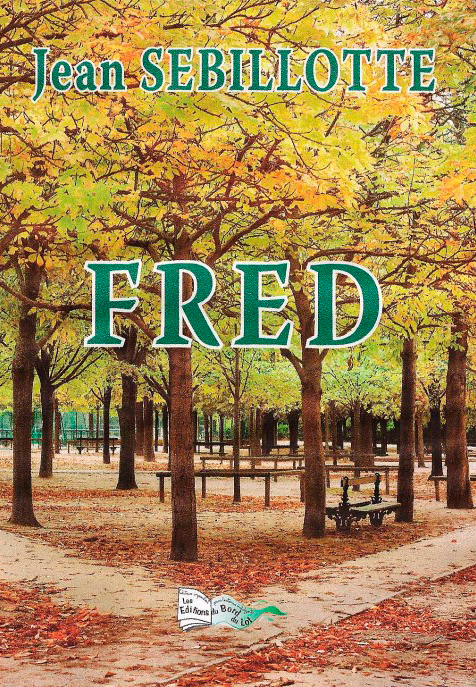 Se procurer ce livre : Editions du bord du Lot
Voir leur site
Se procurer ce livre : Editions du bord du Lot
Voir leur site